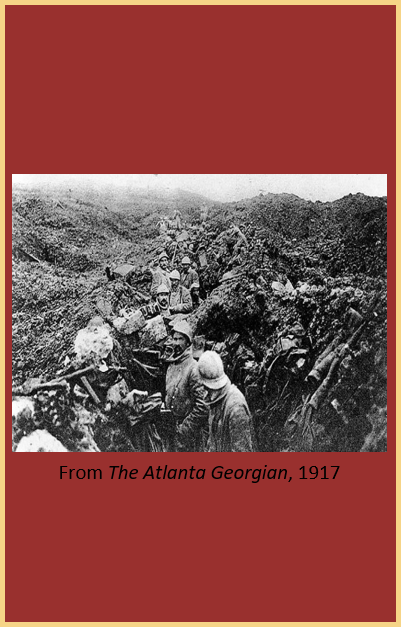Written by René Piegard
Translated by Portia Craig
August 17, 1916
Dear papa,
In the letter that I wrote to mama, I told her how happy we were to find ourselves all in one piece, after the odds of that happening were so against us, thanks to a piece of metal. Finding ourselves alive seems crazy: going for hours without hearing shells whistling overhead…being able to stretch out on the straw…having clean water to drink after the ten of us had fought like wild animals over a quart of muddy, stagnant water in shell holes…being able to eat our fill of a hot meal, with no dirt in it. And that’s when we had something to eat at all. Being able to take off your shoes, to say hello to those who are still left. You must understand that all this happiness, all at first, it’s too much. For a whole day, I was completely out of it. Of course, guard duty changes at night, so imagine us, leaving a small forest where there’s not a single living tree left, no more branches, and the next morning after two or three hours of fevered sleep, and suddenly, we see a row of green chestnut trees, full of life! Finally we see something that creates life instead of destroying it.
For a kilometer on either side of the front lines, there is no trace of any greenery, the ground is gray with gunpowder, constantly ripped up by the shells, with broken boulders, shredded tree trunks, debris that makes it look like there had once been a building there, that there had been “people” there…I thought I’d seen everything. But no, I was wrong. The was still going on over there, we heard gunshots, machine guns, but over here it’s nothing but shelling, shelling; and trenches bombarding each other, bits of flesh flying in the air, blood spattering. You are going to think I am exaggerating, but I’m not. The truth is worse. You wonder how these things can happen. Maybe I shouldn’t describe these atrocities, but people need to know. People should know the brutal truth. And to think that it’s been twenty centuries since Jesus Christ preached on the goodness of men. That there are people who beg for divine generosity. May they recognize his power and compare it to the power of a 380 gauge Boche weapon or a 270 French…poor us! (PPN) (pray for us)
However, we are holding our position, which is admirable. But what defies the imagination, it’s that the Boches continue to attack. I have to say that I have never seen such stubborn, useless sacrifice: whenever they gain some ground, they know what it has cost them and they still can’t hold onto it. I hope to see you again, when we will drink a big glass of wine to the health of your soldier who send you a big hug.
René Piegard
L’originale
A l’assaut des deux rives
Le 6 mars, alors que les combats se poursuivent autour du village de Douaumont, les Allemands lancent une vaste offensive sur la rive gauche de la Meuse. Objectif : prendre en tenaille les Français, depuis les crêtes d’où leur artillerie pourra détruire les positions françaises de la rive droite. Courant mars, de violents affrontements ont lieu pour la possession du village de Cumières, de la côte de ‘Oie, du Mort-Homme ou de la cote 304. Cette fois, les Français disposent de ressources et contiennent la poussée ennemie. Face a cette résistance, les Allemands tentent alors de percer le front en attaquant simultanément sur les deux rives. Ces combats culminent les 9 et 10 avril. Le pilonnage d’artillerie est d’une intensité inouïe. Les Français abandonnent le Mort-Homme mais conservent encore pour un temps le sommet de la cote 304.
Marquis de Beaucorps, 170e RI
« C’est avec un serrement de cœur que j’ai découvert son pauvre corps ou une large coupure affreuse lui barrait le ventre… »
Issu d’une famille d’aristocrates comme beaucoup d’officiers de la Grande Guerre, le marquis de Beaucorps est lieutenant au 170e Régiment d’Infanterie. II rejoint le secteur de Verdun aux derniers jours de février. En ligne au village de Vaux puis devant Douaumont, il rapportera dans ses souvenirs de guerre les souffrances physiques et morales endurées par les hommes de sa section.
Le 6 mars au soir, nous apprenons que nous serons relevés dans la nuit. À un agent de liaison qui passait, je demande le chemin pour ne pas m’égarer. « Suivez, me dit-il, la piste dans la neige, elle vous amené à la ferme de Thiaumont ; vous traversez la cour, ensuite c’est tout droit, mais il faut passer vite, il n’y fait pas bon. » Malheureusement, il ne m’avait pas dit que la ferme était enroulée d’un réseau de barbelés que l’on traversait par une chicane. Comme je n’aimais pas quitter ma section, je n’y ai pas été voir, bien à tort, et je l’ai toujours regretté.
Au début de la nuit, nous avons été relevés par des chasseurs à pied. Ma section se trouvant la première, nous partons les premiers. Par la neige, même dans la nuit, on y voit un peu. Je marchais en tête et suivais sans difficulté la piste indiquée. Mais arrives à la cour de la ferme, nous sommes arrêtés par les barbelés ; la neige était piétinée partout, et pendant qu’avec les premiers hommes je cherche un passage, un fusant vient à éclater juste au-dessus de nous, couchant plusieurs hommes à terre. À droite, le réseau ; à gauche encore le réseau, et dans l’obscurité nous ne trouvons pas d’issue. Le mot de l’agent de liaison me revint à l’esprit : « Il faut passer vite, il n’y fait pas bon. »
C’est alors qu’un obus arrive en sifflant et éclate au milieu de la section, dans un éblouissement. De la confusion, des cris… et je me retrouve presque seul avec autour de moi des formes sombres étendues sur la neige. Une partie de la section, les plus jeunes, avait disparu comme une volée de moineaux, […] et pourtant ces hommes étaient braves, certains même admirablement braves, mais en un instant, ils avaient été frappés de panique. [… ]. Des blesses, le plus rapproche de moi s’était relevé mais ne semblait pas pouvoir marcher, c’était Fournier, un petit boulanger de Lyon, amusant, assez gavroche, mais bien gentil Pour l’aider à se dégager, j’essayai de l’entraîner hors du réseau. « Oh ! mon fusil, mon fusil ! » cria-t-il. Croyant qu’il faisait allusion à un ordre d’après lequel les blessés ne doivent pas abandonner leurs armes, je lui dis : « Mais laissez-le, votre fusil, laissez-le ! » et je le tirai plus fortement encore. Cette fois, ce fut un véritable cri de douleur: » Oh ! mon bras. Oh ! mon bras. » Et le regardant je vois avec horreur, dans la demi-clarté de cette nuit de neige, son malheureux bras casse au coude, ouvert, l’os complètement sorti, pris dans la bretelle du fusil, lui-même accroche dans les barbelés. Plus je tirais et plus je lui arrachais le bras. Alors seulement, je libérai ce pauvre bras brisé et saignant. La blessure était affreuse et il a dû être amputé. Heureusement peut-être, car pour lui la guerre était finie. […]
Comme Malpas arrivait avec sa section, je lui demandais d’emmener ce qu’il restait de la mienne pendant que je m’occupais des blessés. Trois hommes gisaient dans la neige, deux ne bougeaient plus, le troisième était Botzi, mon ordonnance. Je lui dis de m’attendre et qu’après avoir emmené Fournier au poste de secours, je viendrais le chercher avec des brancardiers. À notre arrivée dans le secteur, j’avais repéré un poste de secours dans l’« ouvrage de Thiaumont », petit fortin dont nous n’étions pas loignés. J’y laissai Fournier et demandai deux brancardiers pour venir avec moi prendre les blessés. Arrivé à la ferme, je fais d’abord emmener Botzi, puis, m’aidant d’une lampe électrique sous un pan de ma capote, je reconnais par terre Dargnat, un Auvergnat d’une trentaine d’années arrivé récemment avec un renfort. Un brave homme séreux et avec une bonne conduite. Il était mort. L’autre avait la moitié de la tête emportée, il était complètement défiguré, méconnaissable. Revenu au paste de secours, je fais mettre le brancard de Botzi dans un coin et, à genoux près de lui, je défais le plus doucement possible, mais bien maladroitement avec mes doigts engourdis par le froid, ses vêtements collés par le sang. C’est avec un serrement de cœur que j’ai découvert son pauvre corps ou une large coupure affreuse lui barrait le ventre et d’où sortaient des débris d’intestin et des morceaux de foie. Un médecin qui passait hocha la tête et s’éloigna. Lui, étendu, ne pouvant voir sa plaie, me demanda : « Est-ce grave ? » Je ne pus que lui répondre : « Oui, c’est bien grave. » Et comme je le savais bon chrétien, pratiquant, j’ajoutai : « Je vais vous chercher un prêtre. » Il y en avait presque toujours parmi les brancardiers et je trouvai.
En revenant près de Botzi, je le trouvai rigide et se plaignant du froid. Ah ! qu’elle est donc navrante cette phrase de tant de blessés : « J’ai froid. » Le froid de la mort ! Pauvre petit Botzi, il allait mourir. A la guerre, on ne peut s’attendrir ni même rester à consoler les blesses que l’on sait perdus. À l’arrivée de l’aumônier, j’embrassai Botzi sur le front, comme j’aurais fait pour un enfant, je lui dis adieu et je partis dans la nuit.
René Piegard